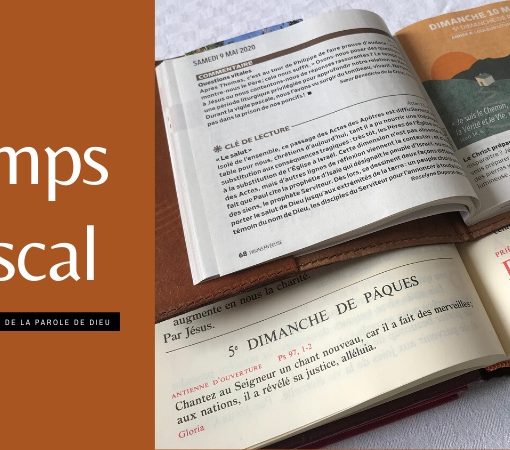Quelques réflexions sur la crise actuelle
En nous invitant à scruter les signes des temps, la Constitution Gaudium et spes nous invite à dépasser une vision de l’histoire marquée par une coupure entre l’histoire profane et l’Histoire du Salut. « L’Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l’Évangile de telle sorte qu’elle puisse répondre d’une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques.[1] »
Dans cette perspective, nous pouvons considérer la crise sanitaire actuelle, qui voit le confinement de la moitié de l’humanité, comme un de ces événements majeurs de l’histoire des hommes, au travers desquels s’écrit l’Histoire du Salut.
L’apparition de l’épidémie du covid-19 a coïncidé, chez nous, avec le commencement du carême. L’Église, à travers le rite de l’imposition des cendres, nous a introduits, sans que sur le moment nous nous en rendions compte, à ce temps de désert si particulier cette année. Elle l’a fait avec ces paroles qui nous viennent du fond des âges : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière[2] ». A posteriori, nous sommes saisis par le réalisme de ces paroles. D’autant plus saisis, que c’est une réalité que nous avions presque réussi à oublier. Notre tendance naturelle au divertissement pascalien avait été décuplée, centuplée par les progrès de la technique et de la science. Nous pensions avoir pris le contrôle de l’économie, de la nature et même de notre destin. Dieu avait créé l’homme ? Nous allions créer l’homme augmenté, le surhomme, et bientôt entrer dans l’ère, supposée merveilleuse, du transhumanisme. Le darwinisme n’en était qu’à ses commencements et le promoteur des évolutions à venir serait l’homme lui-même ! Les rêves caressés par Condorcet, qui, au siècle des Lumières, spéculait sur les possibilités d’appliquer les sciences médicales à l’extension infinie de la vie humaine, les rêves de Benjamin Franklin, qui pensait pouvoir interrompre et relancer le cours de la vie au moment choisi, étaient sur le point de se réaliser. La génétique moderne allait leur donner corps et l’on ne pourrait qu’admirer l’heureuse audace du progrès, le triomphe de la modernité. Modernité toute relative d’ailleurs, puisque déjà Plotin, dans les Ennéades, invitait l’homme à sculpter lui-même sa propre statue jusqu’à ce qu’il voit sa propre beauté. L’homme serait enfin son propre créateur. Prométhée allait triompher et avec lui l’antique serpent de la Genèse : « Vous serez comme des dieux[3] ».
Sur le plan économique, la même démesure s’était imposée. Les moyens de communication et de déplacement donnaient à l’homme nouveau un champ d’action à la mesure de la planète. Les prétextes les plus humanitaires et les plus émancipateurs avaient supprimé les frontières au profit du développement de l’économie de marché et de la finance internationale, ce qui avait entraîné le « dumping social » puis la désindustrialisation des pays dont les peuples s’étaient dotés d’une législation du travail protectrice. On rendait hommage aux acquis sociaux des luttes syndicales tout en localisant les entreprises dans les pays où une main d’œuvre sans protection, pour des salaires de misère, fournissait le monde en biens de consommation auxquels elle n’aurait pas accès.
Le Pape François établit une corrélation entre la globalisation de l’économie et la globalisation de la misère, comme il met en perspective les structures économiques mondialisées avec la destruction des écosystèmes, des cultures locales et de la planète elle-même. L’empreinte carbone des produits importés et l’absence de normes écologiques des pays producteurs ne sont pas sans incidence sur les perturbations atmosphériques et climatiques. Ainsi, la clameur de la terre rejoint la clameur des pauvres[4].
L’homme libéré des superstitions et des contingences de la nature s’était donné de nouveaux maîtres et s’était fait de nouveaux esclaves, créant ainsi ce que Jean-Paul II qualifiait de structures de péché. « Le péché rend les hommes complices les uns des autres, fait régner entre eux la concupiscence, la violence et l’injustice. Les péchés provoquent des situations sociales et des institutions contraires à la bonté divine. Les structures de péché sont l’expression et l’effet des péchés personnels. Elles induisent leurs victimes à commettre le mal à leur tour. Dans un sens analogique, elles constituent un péché social[5] ».
Mais cette notion de « péché » était devenue inaudible depuis plusieurs générations ; elle n’avait plus de sens et a été effacée par la recherche d’une auto-rédemption qui a exclu Dieu de la société. L’exclusion de Dieu de la société, la disparition du champ de la conscience humaine de toute fin transcendante a créé cette situation dans laquelle le primat de l’économie s’est imposé à l’homme. L’économie n’est plus au service de l’homme, c’est l’homme qui est au service de l’économie. Dès lors, « l’inversion des fins et des moyens qui aboutit à donner valeur de fin ultime à ce qui n’est qu’un moyen d’y concourir, ou à considérer les personnes comme de purs moyens en vue d’un but, engendre des structures injustes qui rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne conforme aux commandements du Divin Législateur[6] ».
La société des hommes peut-elle s’édifier dans le rejet systématique de tous les commandements de Dieu ? L’homme peut-il congédier Dieu ? Après avoir rejeté Dieu de la vie publique, l’homme peut-il aussi rendre impossible l’observance de ses commandements dans la sphère de la vie privée ? Peut-il éteindre sa lumière dans la conscience personnelle jusqu’à faire disparaître la perception même de la structure de péché et supprimer l’envie de s’en libérer ? Les traces du collier du chien de La Fontaine sont la garantie de sa pitance en même temps que le signe de sa sujétion.
« Le grand malheur de nos contemporains, écrivait Chesterton, n’est pas de ne croire à rien : leur malheur est de croire à tout et n’importe quoi, à n’importe qui ».
L’image biblique du Veau d’or s’impose à l’esprit de façon assez évidente. Revisitée par Goethe et par Gounod dans la légende de Faust, son actualité est d’autant plus criante :
« Le veau d’or est toujours debout !
On encense sa puissance
D’un bout du monde à l’autre bout
Pour fêter l’infâme idole
Rois et peuples confondus
Au bruit sombre des écus
Dansent une ronde folle
Autour de son piédestal
Et Satan mène le bal ! »
Mais, c’est une autre image biblique qui m’habite en ce temps de confinement : le songe de Nabuchodonosor dans le Livre de Daniel[7]. Il n’y a pas d’armure sans défaut, il n’y a pas de colosse sans pied d’argile. La pierre qui se détache de la montagne et vient pulvériser le pied d’argile du colosse prend ici la figure d’un micro-organisme, un virus qui tue, qui, en quelques semaines, cloue les avions au sol, confine la moitié de l’humanité, affole la bourse, fait vaciller les places financières, détruit les emplois, « d’un bout du monde à l’autre bout ».
Le rêve de grandeur de l’homme s’effondre par les conditions de vie mêmes qu’il a créées. La globalisation des relations entraîne la globalisation de la pandémie tandis que nos pays, ayant renoncé leur autonomie alimentaire et médicale, sont obligés de faire face à des risques de pénurie avant même d’avoir éradiqué l’épidémie.
Dans le dernier livre qu’il nous a offert, l’année même de sa mort, « Mémoire et Identité », Jean-Paul II écrit que Dieu met toujours une limite au mal. « On peut dire que l’histoire de l’homme est, depuis les origines, marquée par la limite que le Dieu Créateur impose au mal. Le Concile Vatican II s’est beaucoup exprimé sur ce thème dans la Constitution pastorale Gaudium et spes[8] ». Et de fait, sans vouloir entrer dans ce que d’aucuns appellent la théologie de l’histoire, la simple observation nous montre que les rêves prométhéens de l’homme s’effondrent toujours et, le plus souvent, par implosion sous l’action de leur principe organisateur lui-même. Et cette implosion du mal ouvre, paradoxalement, un espace propice au bien. « Goethe n’a-t-il pas qualifié le diable comme une partie de cette force qui toujours veut le mal et toujours crée le bien. Saint Paul, pour sa part, lance un avertissement à ce propos : « Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien » (Rm 12, 21). En définitive, on arrive ainsi, sous l’incitation du mal, à mettre en œuvre un bien plus grand[9] ».
Apparue chez nous avec le carême, la pandémie qui nous frappe nous renvoie en pleine figure la réalité de notre vulnérabilité foncière : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière[10] ». Elle nous pousse à reconnaitre avec honnêteté que la seule affirmation certaine et indiscutable que nous puissions tenir est que l’homme est un mystère fragile. L’homme est un roseau disait Pascal, mais c’est un roseau pensant[11]. Chacun d’entre nous sait très bien qu’il est né et qu’il mourra. Ce n’est pas l’annonce d’une catastrophe, c’est la simple réalité.
Comme chrétiens, nous savons qu’il y a une autre réalité toute aussi sûre, toute aussi indiscutable, c’est la théologie du salut. C’est-à-dire la fin dernière à laquelle nous sommes appelés. Cette fin n’est pas le néant, c’est Dieu. Au cœur de notre fragilité, le Verbe de Dieu a pris chair et a fait briller sur nous la lumière de sa résurrection. C’est au cœur de notre vulnérabilité, dans l’extrême fragilité de la croix et pas dans nos rêves de puissance, que nait l’espérance du salut qui est notre véritable force. Un salut que nous ne construisons pas par la réalisation de nos désirs prométhéens mais que nous recevons de l’amour de Dieu révélé en Jésus-Christ dans le mystère pascal. « J’en ai la certitude : ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les Principautés célestes, ni le présent, ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur[12] ». Ce ne sera pas non plus le coronavirus.
Aidons-nous donc les uns les autres à voir dans la misère de notre fragilité humaine redécouverte, la main de Dieu qui nous guide sur le seul chemin qui conduit à la maison du Père. D’ici là, que les roseaux pensant que nous sommes, réfléchissent à l’avenir et à la manière dont il nous faudra, après la crise, construire une civilisation digne de notre fragilité et du mystère de salut qu’elle porte.
+Raymond Centène
Evêque de Vannes
[1] Gaudium et spes n°4
[2] Genèse 3, 19
[3] Genèse 3, 5
[4] Cf. Laudato Si n° 49
[5] Catéchisme de l’Eglise catholique n°1869
[6] Catéchisme de l’Eglise catholique n°1887
[7] Daniel 2, 31 ss
[8] Mémoire et Identité, Jean-Paul II, Editions Flammarion, Mars 2005, page 31
[9] Mémoire et Identité, Jean-Paul II, Editions Flammarion, Mars 2005, page 28
[10] Genèse 3, 19
[11] Pensées, Pascal, Livre de Poche Collection Classique, Edition de Août 2000, Liasses I-XV
[12] Romains 8, 38-39